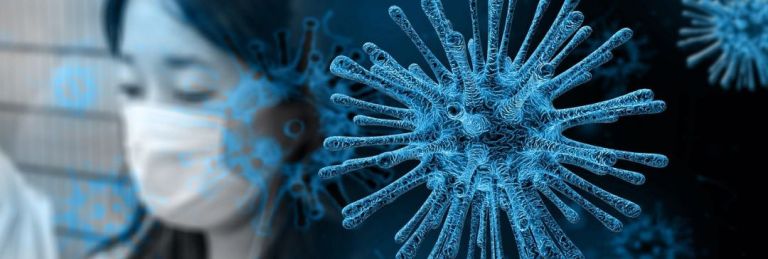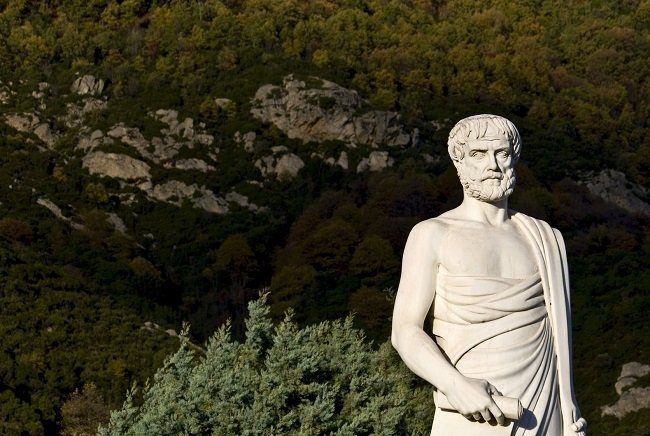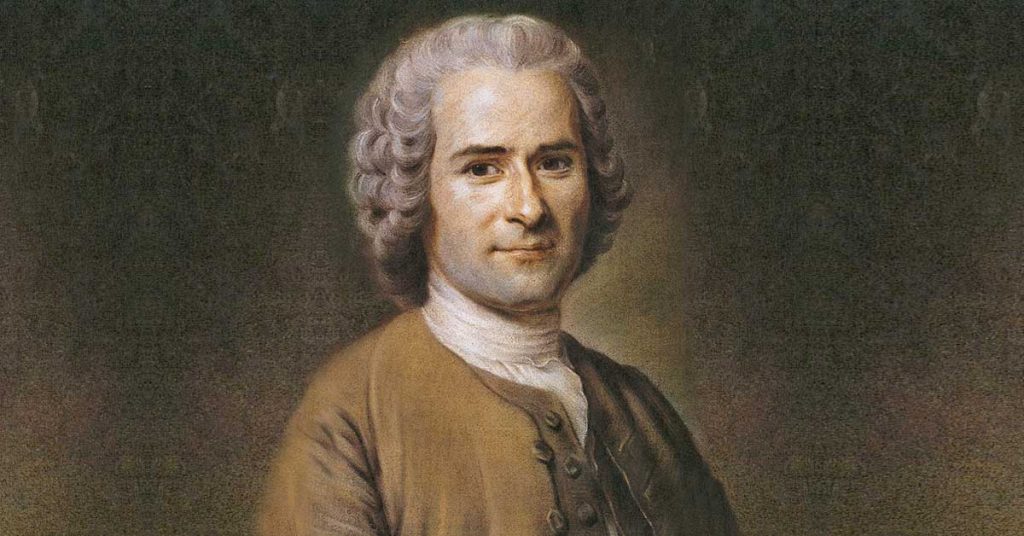L’amour peut-il être intellectuel ?
Posted in Articles on juillet 15th, 2023 by admin – Commentaires fermésDans l’Éthique Spinoza parle d’un amour intellectuel de Dieu et va jusqu’à affirmer que cet amour conduit à la béatitude, c’est-à-dire à la joie suprême. Cette expression « amour intellectuel » peut sembler étrange à beaucoup d’entre nous puisque nous ne sommes pas accoutumés à relier nos sentiments et notre intellect. Nous avons plutôt l’habitude de les séparer, voire de considérer qu’ils se limitent réciproquement. Selon notre manière courante de voir les choses, nous avons plutôt tendance à penser que l’intelligence conduit à la froideur et que les affects troublent notre jugement et notre manière de raisonner. Aussi, pour bien comprendre ce que Spinoza entend par cette formule, il nous faut revenir aux définitions que donne Spinoza des termes qui la composent. En premier lieu, il faut préciser que l’objet de cet amour n’est pas un Dieu caché et mystérieux et encore moins un Dieu anthropomorphe et personnel. Il ne faut jamais oublier que lorsque Spinoza parle de Dieu, il parle de la nature qu’il faut comprendre comme un système de lois, c’est-à-dire de rapports complexes, mais constants, entre tous les éléments qui la composent. Par conséquent, plus on comprend cette nature, par la philosophie, la science, par toutes les formes de perception que nous en avons, plus nous connaissons Dieu. Ensuite, il nous faut préciser ce qu’est l’amour et Spinoza en donne une définition on ne peut plus claire : « L’Amour est une Joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure », mais qui nécessite pour être comprise que l’on se réfère également à la définition qu’il donne de la joie : « La Joie est le passage de l’homme d’une moindre à une plus grande perfection ». Par perfection, Spinoza entend ici puissance, puissance d’être, puissance d’agir, puissance de penser. Pour dire encore les choses différemment, plus nous nous sentons capables de faire des choses, plus nous nous sentons joyeux. Par conséquent, si nous percevons une chose extérieure comme contribuant à augmenter nos capacités, nous l’aimons. Bien entendu, nous pouvons nous tromper, nous pouvons imaginer qu’une chose augmente notre puissance, alors qu’en réalité, elle fait tout le contraire. Dans ces conditions, l’amour est passif et repose sur une idée erronée, ce que Spinoza appelle une idée inadéquate. Dans ce cas d’ailleurs je ne me sentirai pas véritablement plus puissant en présence de la chose aimée, j’aurai simplement peur de me sentir plus faible, moins capable, en son absence.
En revanche, lorsque je comprends clairement l’effet que produit sur moi la chose aimée, je vais ressentir un amour plus actif et plus intense. On pourrait objecter que toute compréhension d’une chose n’entraîne pas nécessairement une modification de nos affects. Ainsi, si une personne m’a causé un tort, on n’aura beau m’expliquer les raisons qui l’ont conduit à agir comme elle l’a fait, on aura beau m’expliquer qu’elle bénéficie de nombreuses circonstances atténuantes ou qu’elle n’était pas lucide au moment où elle a agi et qu’elle n’était pas responsable de ses actes, cela ne m’empêchera pas de ressentir de la haine envers elle, c’est-à-dire une tristesse accompagnée de la représentation de cette personne.
Il faut donc, pour bien comprendre ce que veut dire Spinoza, s’interroger sur le mode de compréhension auquel il fait référence, lorsqu’il parle d’amour intellectuel. L’intellect auquel il fait référence n’est pas la raison purement démonstrative et finalement abstraite et désincarnée. Cette dernière est fort utile dans les sciences et nous aide grandement à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais elle n’aboutit qu’à des généralités. Elle permet, par exemple en physique, de découvrir les lois générales du mouvement, ce qui est déjà beaucoup, mais n’est pas suffisant pour modifier en profondeur notre ressenti.
L’intellect dont il est question, lorsque l’on parle de l’amour intellectuel de Dieu, relève d’une pensée plus intuitive et plus incorporée, il concerne une perception plus fine des liens qui nous unissent à la nature. Spinoza précise d’ailleurs dans le Traité de la réforme de l’entendement que cette joie suprême à laquelle il aspire ne peut venir que de la compréhension des liens par lesquels « notre esprit est uni à la nature tout entière ». Et quand on sait que pour Spinoza l’esprit et le corps ne sont qu’une seule et même chose on saisit mieux en quoi l’intellect dont il est ici question ne peut pas être désincarné et pourquoi l’amour peut être intellectuel. Il n’y a pas d’un côté les sentiments qui s’enracineraient dans le corps qui serait l’instance sensible de l’être humain et de l’autre l’intellect qui relèverait de l’esprit. L’unité du corps et de l’esprit fait que l’intellect et la raison sont autant sensible que la sensibilité peut faire preuve d’intelligence. Il s’agit donc de comprendre les choses dans leur singularité, toute chose singulière étant l’expression de la puissance de la nature et comme cette compréhension consiste en une augmentation de puissance, elle ne peut être que source de joie. Par conséquent l’amour étant une joie accompagnée de l’idée de sa cause, plus je comprends une chose de cette manière plus je vais l’aimer et comme toute chose exprime la puissance de Dieu ou de la nature, plus je comprends une chose plus j’aime Dieu. Comprendre prend alors ici tout son sens, il s’agit de prendre avec soi ou plutôt de découvrir en soi tout ce qui nous relie à la totalité de la nature. Comprendre une chose consiste à comprendre de quelle manière celle-ci est comprise dans une nature qui me comprend également, c’est donc progresser dans la saisie intuitive des liens qui nous unissent à la nature.
Un amour intellectuel est donc possible, il est même la forme la plus élevé de l’amour, sa forme la plus active, mais il nécessite pour pouvoir s’exprimer et se manifester que l’on dépasse la conception réductrice et borné que nous avons de l’intellect qui n’est pas une puissance de pensée froide et désincarnée, mais l’expression d’un esprit vivant qui ne fait qu’un avec le corps. S’efforcer de comprendre l’autre, c’est donc toujours s’efforcer de l’aimer et cet amour ne peut passer que par la compréhension des liens qui nous unissent à lui.
Éric Delassus