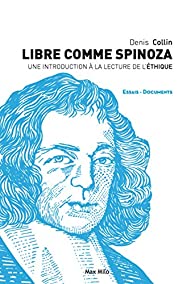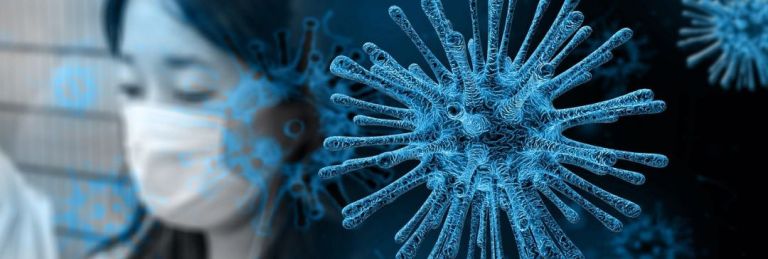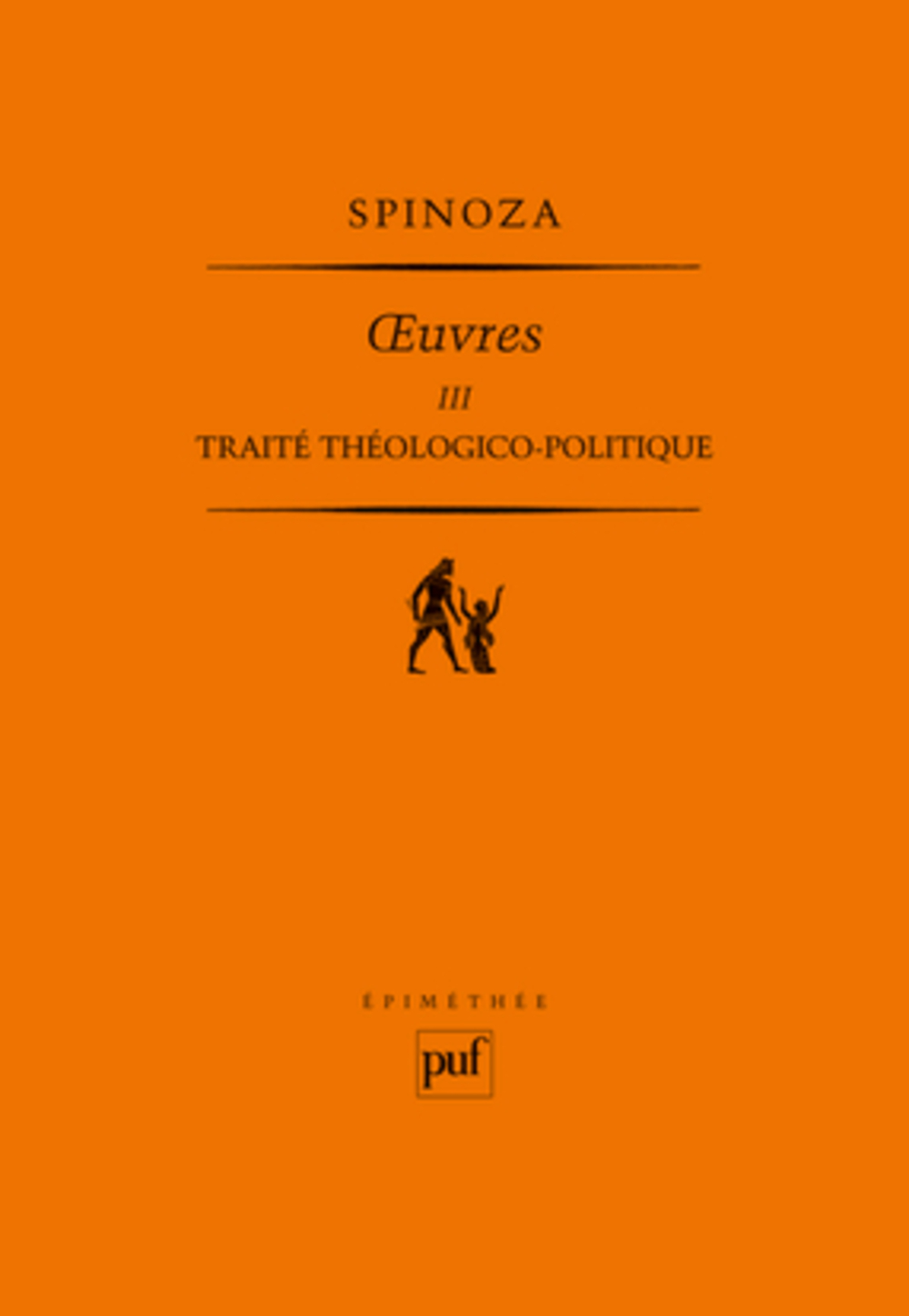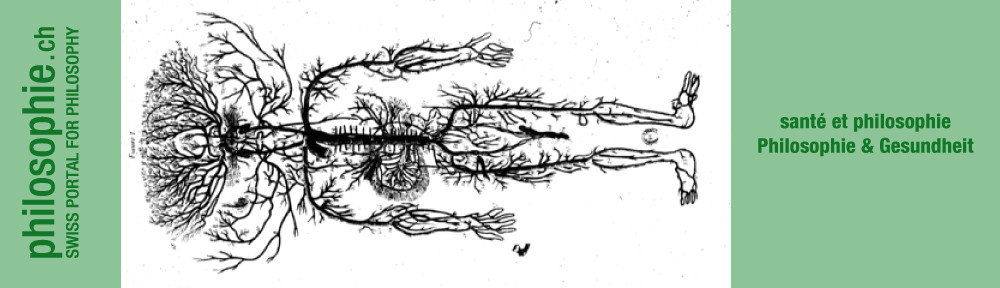Singularité, altérité, créativité
Posted in Articles on octobre 16th, 2023 by admin – Commentaires fermésCommunication prononcée lors du séminaire de l’ IRISA Institut des 14 et 15 octobre 2023.
Pour bien comprendre ce que signifie la notion de singularité, il convient de la distinguer de celle de particularité avec laquelle on a parfois tendance à la confondre. En effet, une chose peut très bien être particulière sans être singulière. Un ensemble peut être composé d’éléments tous identiques, chacun est particulier en tant qu’il est une partie d’une totalité qu’il compose, mais il n’est pas singulier dans la mesure où il n’y a rien qui le distingue des autres éléments de l’ensemble. Le singulier désigne par définition ce qui n’a pas son pareil, ce qui est unique et qui se distingue de ce qui lui est semblable, mais pas identique.
C’est en ce sens que la singularité est constitutive de l’altérité. Ce qui fait l’altérité de l’autre, ce qui fait qu’il n’est pas simplement mon semblable, mais qu’il y a en lui quelque chose qui lui est propre et qui m’échappe, c’est justement ce qui fait sa singularité. Cette singularité fait qu’aucune personne humaine n’est substituable à une autre, qu’elle ne peut être équivalente d’une autre. Même si elle doit être considérée comme égale aux autres d’un point de vue moral ou politique, elle ne lui est pas équivalente au sens où elle ne peut en remplacer une autre ou être remplacée par elle. La singularité fait le mystère de l’autre, ce que je peux saisir totalement, ce dont je ne peux avoir qu’une vague intuition, ce qui fait sa personnalité et dont une partie ne peut être saisie que de manière progressive, diffuse sans faire l’objet d’une véritable connaissance, mais plutôt d’une expérience qui me révèle en permanence des aspects nouveaux que parfois je ne soupçonnais pas. La singularité est donc ce qui fait à la fois le mystère et la richesse d’autrui.
Cette singularité, nous pouvons la cultiver comme nous pouvons l’étouffer. Nous sommes même parfois enclins à faire taire notre singularité, par le conformisme, le désir de se fondre dans la masse et de ne pas se faire remarquer. Il est parfois, pour ne pas dire souvent, difficile d’assumer sa singularité, car si la singularité est constitutive de l’altérité, il n’est pas toujours évident de l’exposer au regard de l’autre dont nous pouvons craindre le jugement. Nous aspirons à ce que notre singularité soit reconnue par autrui, mais nous pouvons craindre en même temps qu’elle soit jugée négativement, rejetée ou tournée en dérision.
C’est pourquoi il est essentiel de développer une culture de la singularité, c’est-à-dire de faire en sorte que chacun puisse assumer, développer et enrichir sa singularité tout en apprenant à accepter la singularité de l’autre et à laisser s’exprimer sa créativité dans le processus par lequel nous nous ouvrons à de nouvelles manières d’être, nous laissons s’épanouir librement toutes nos aptitudes.
Cette culture de la singularité passe certainement par un apprentissage qui lui-même repose sur l’acte d’adopter une certaine disposition du corps et de l’esprit. Apprendre tout d’abord à observer pour se rendre compte que la nature produit finalement peu d’uniformité, mais s’accomplit pleinement et fait naître toute sa richesse de la diversité en donnant le jour à des choses toujours singulières. Regarder, par exemple, deux roses d’un même rosier, deux fruits d’un même arbre, aucun n’est parfaitement identique à l’autre, ils possèdent tous leur singularité. Vu sous cet angle, on peut affirmer qu’il y a une sorte de créativité de la nature dans son aptitude à produire de la singularité. C’est un peu, d’ailleurs, ce qu’avait bien vu Spinoza pour qui il n’existe en réalité que des choses singulières qui sont l’expression de la puissance de Dieu ou de la nature. Les termes génériques ne sont pour lui que des êtres de raison, des termes commodes pour désigner des choses possédant de nombreux points communs, mais la réalité est toujours constituée de singularités. C’est pourquoi, on peut parler à ce sujet, d’un nominalisme de Spinoza puisqu’il n’accorde pas de réalité substantielle aux termes généraux. Ainsi, le mot « arbre » ne désigne pas une réalité en soi, « l’arbre » n’existe pas, ce qui existe, ce sont des choses singulières que l’on nomme ainsi parce qu’elles possèdent de nombreux points communs, mais qui en réalité possèdent toutes leur singularité. Vous ne verrez jamais deux arbres, même d’une espèce identique, parfaitement indiscernables. Il y aura toujours quelques détails qui les distingueront.
Ainsi, même si pour Spinoza la nature est un système de lois constantes – Spinoza s’appuie, entre autres, sur la physique galiléenne pour élaborer ce qu’il entend par Dieu ou la nature et les lois de la physique sont les mêmes de toute éternité – la complexité de ce système est telle, et les interactions causales qu’il produit sont d’une telle multiplicité, qu’il ne peut produire que des choses singulières. Mais des choses singulières qui sont toutes reliées à la totalité de la nature dont elles sont l’expression de la puissance. C’est d’ailleurs ce qui explique cette formule de Spinoza : « plus je comprends les choses singulières, plus je comprends Dieu ».
C’est cette complexité du réel qui rend possible ce lien entre singularité et créativité. La nature est, en quelque sorte créative, dans la mesure où elle produit sans cesse de la singularité et toute singularité est, dans une certaine mesure, créative dans la mesure où ce qu’il y a de singulier en elle agit sur le réel de telle sorte qu’elle contribue à faire émerger sans cesse de la nouveauté. Certes, toute singularité n’est pas systématiquement créative, mais on peut dire que toute singularité assumée, développée l’est. C’est pourquoi, il est essentiel pour développer sa créativité de cultiver sa singularité. C’est lorsque la singularité est étouffée, inhibée et aliénée que la créativité s’étiole et se trouve comme bâillonnée par les conventions sociales et le conformisme ambiant. En revanche, lorsque pour parler comme Spinoza, un être laisse s’exprimer la seule nécessité de sa nature, il va pouvoir plus facilement laisser s’exprimer sa créativité. Que ce soit dans le domaine artistique, technique, scientifique ou tout simplement dans la vie quotidienne et les relations sociales en inventant des manières d’être nouvelles et parfaitement adaptées aux situations qu’il est en train de vivre.
Au sujet de la notion de création, il convient d’ailleurs d’apporter ici quelques précisions concernant la définition que l’on peut donner de ce terme qui appartient autant au vocabulaire artistique que théologique. Peut-être est-ce d’ailleurs à partir de sa signification théologique que s’est formée sa signification artistique ? En effet, créer signifie d’abord donner l’être. Faire être à partir de rien. Le terme de création au sens fort signifie nécessairement création ex nihilo. Il s’agit d’un acte qui relève du miracle. Et si l’on parle de création artistique, n’est-ce pas parce que l’on est tenté de penser ou de croire que l’artiste est comme un dieu par rapport à ce qu’il produit. Il ne s’agit, certes, que d’une analogie, mais d’une analogie qui donne à penser, d’autant que la création qu’elle soit divine ou artistique a quelque chose à voir avec le langage. En effet, la Bible nous dit qu’au commencement était le verbe, c’est-à-dire la parole de Dieu dont la puissance apparaît comme créatrice. Indépendamment de toute conviction religieuse, on peut interpréter cette formule de manière métaphorique ou allégorique exprimant la créativité du langage quelle que soit la forme qu’il prenne, qu’il s’agisse du langage des mots ou de celui des images et des formes. Le langage nourrit l’imagination créatrice et actualise des potentialités singulières dans l’esprit de celui qui crée. Si l’on prend l’exemple de la création littéraire, on peut dire que chaque œuvre est singulière et qu’elle consiste dans l’émergence d’une potentialité contenue dans la langue de l’auteur et qui voit le jour grâce à sa puissance créatrice.
Il peut néanmoins sembler curieux de s’inspirer de la philosophie de Spinoza pour penser la création et la créativité dans la mesure où sa métaphysique n’est en rien créationniste. En effet, le Dieu de Spinoza n’est pas un dieu créateur puisqu’il est assimilé à la nature, raison pour laquelle d’ailleurs Spinoza fut à son époque accusé d’athéisme et qui explique qu’aujourd’hui certains athées se réclame de sa philosophie. Dieu n’a pas créé la nature, il est la nature, qui existe de toute éternité. Il n’y a donc pas, à proprement parler, dans sa philosophie de création puisque créer signifie faire être ce qui n’était pas. C’est pourquoi, l’idée de création au sens fort de ce terme possède un caractère totalement irrationnel et suppose une émergence, une venue à l’existence totalement ex nihilo, c’est-à-dire un passage du non-être à l’être dont la raison ne peut rendre compte. L’idée de création au sens fort s’oppose aussi bien au principe d’identité qu’au principe de non-contradiction qui sont tous deux issus de l’ontologie parménidienne et sont présents aux fondements de la logique aristotélicienne. Si l’on se réfère à la mythologie grecque, il n’est d’ailleurs jamais question de création. Au commencement, il y a quelque chose, une singularité informe, indéterminée qui va produire le monde en donnant naissance à Gaia la terre qui produira Ouranos le ciel puis de leur union naîtront d’autres divinités. Si on lit le Timée de Platon, on se trouve dans une configuration similaire, il y a la matière informe d’un côté et le monde intelligible de l’autre, monde des formes et le démiurge, dieu ordonnateur, met en forme le monde sensible en prenant modèle sur les idées du monde intelligible. À aucun moment, il n’est question de création.
Avec Spinoza, qui, d’une certaine façon concilie la mobilité héraclitéenne (« on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. ») et l’ontologie parménidienne (l’être est toujours identique à lui-même) la problématique de la création se pose également. Dans une perspective spinoziste, il serait plus juste de parler de production plutôt que de création, puisque Dieu produit à partir de sa propre puissance des manières d’être qui sont les choses singulières. Comment rendre compte, dans ces conditions, de la création artistique ?
Il ne s’agit pas alors d’une création ex-nihilo, mais il s’agit quand même d’un acte qui a à voir avec la création dans la mesure où il consiste à faire venir au monde une réalité absolument nouvelle, une réalité singulière qui n’aurait pas été si celui qui l’a réalisé n’avait pas été emporté par l’élan créateur qui lui a donné le jour. On peut donc considérer que tout créateur, par exemple un artiste, joue un peu un rôle de médiateur à l’intérieur même de la nature pour faire être des manières d’êtres, des choses singulières dont l’idée est de toute éternité présente dans l’entendement divin et que la puissance d’agir de Dieu ou de la nature a rendu réel en prenant comme médiateur l’imagination et le corps de l’artiste. La puissance de l’artiste est ici une expression, une manière d’être de la puissance de la nature qui s’exprime par la production de choses singulières.
Créer consiste donc ici à faire émerger des manières d’être, des modalités de la puissance de la nature à travers une puissance singulière. C’est à partir de cette manière de voir les choses qu’il faut comprendre la formule de Spinoza « plus je comprends les choses singulières plus je comprends Dieu », car chaque chose singulière contient en elle-même toute la puissance de la nature dont elle est l’expression. Il suffit donc de laisser parler notre nature pour que notre singularité, en s’exprimant, devienne créative. Cette singularité créative, parce qu’elle est l’expression de ce à quoi nous sommes intrinsèquement reliés, parce qu’elle n’est pas le fruit d’une singularité dissociée des autres singularités, mais qu’elle exprime leurs interactions ne peut que s’ouvrir aux autres. Parce qu’elle est expression, elle est nécessairement projection hors de soi vers autrui, car cette puissance créatrice n’est autre que le désir.
La notion de désir est fondamentale dans la pensée de Spinoza qui va jusqu’à affirmer que le désir est l’essence de l’homme. Autrement dit, ce que veut nous signifier ici Spinoza, c’est que l’être humain est désir et que ce désir le fait être. De plus, Spinoza analyse le désir en mettant en évidence sa dimension essentiellement positive, puisqu’il le définit comme puissance, ce qui est tout à fait original si on se réfère aux autres théories du désir qui l’ont précédé. En effet, depuis Platon, le désir est le plus souvent défini comme manque, comme désir d’un objet que l’on ne possède pas. Or, pour Spinoza, le désir va principalement se présenter comme désir d’être et puissance d’agir. Le désir est ici le moteur de la vie, il est l’expression de ce que Spinoza nomme en latin, le conatus, c’est-à-dire « l’effort pour persévérer dans l’être » qui se manifeste en toute chose, mais qui prend la forme de l’appétit chez les êtres vivants et du désir chez l’être humain chez qui il se définit comme « l’appétit avec la conscience de l’appétit ». Il faut ici être prudent sur le sens à donner au terme d’effort qui est la traduction littérale du terme latin conatus, mais qui ne relève pas de cette tension de la volonté, à laquelle nous faisons habituellement référence lorsque nous utilisons ce terme. Il y a en fait deux interprétations du terme de conatus à proscrire si l’on veut éviter les contresens. Le conatus n’est ni à prendre dans un sens volontariste ni en lui donnant une signification vitaliste. Il ne s’agit pas plus d’une tension de la volonté que d’une énergie vitale, le conatus résulte de la manière dont s’agence les différents constituants d’un individu et plus ces éléments constitutifs sont en convenance plus le conatus de l’individu est puissant. Ce qu’il faut bien comprendre ici, c’est que chez Spinoza un individu n’est pas, comme le sens étymologique et littéral de ce terme pourrait le laisser croire, une chose indivise, mais une réalité composée et composante, composée de parties qui possèdent d’ailleurs chacune leur conatus et composante d’un individu plus grand que lui. C’est lorsque ces parties s’agencent pour le mieux que la puissance d’être d’une chose singulière augmente. En revanche, si la structure d’une individualité est fragilisée par l’action d’une cause externe, sa puissance diminue.
Ainsi, ce qui fait la singularité d’un individu résulte de l’interaction entre structure interne et causalité externe. Ce jeu de l’interne et de l’externe constitue ce que Spinoza désigne par le terme de complexion. La complexion d’un individu renvoie à sa structure interne ainsi qu’aux relations qu’il entretient avec son environnement. Ainsi, une pierre, si elle se situe dans un environnement dans lequel elle n’est pas exposée à l’érosion ou à des chocs qui pourraient la briser, persévérera dans son être autant qu’il est en elle et maintiendra sa structure à l’identique. Mais la complexion de la pierre est relativement simple. Il n’en va pas de même pour les êtres vivants dont la complexion est plus grande et, parmi eux, l’être humain est certainement celui qui dépasse tous les autres en complexité. En effet, sa structure interne est d’une grande richesse, mais de plus, il possède une grande aptitude à affecter le monde extérieur et à être affecté par lui. En effet, un être humain est le produit de son hérédité biologique, de son environnement social et affectif, de son histoire personnelle et des événements qui ont traversé sa vie. Aussi, dans la mesure où tout être humain est le produit de cette multiplicité d’interactions d’origines diverses, il sera toujours singulier. Aucun de nous n’a la même histoire, n’a vécu dans les mêmes conditions et chaque individu apparaît donc comme une expression singulière de la puissance de la nature et plus il assumera cette singularité, plus il la comprendra, plus il pourra être créatif. Car cette singularité caractérisera aussi son désir et sera en lui source de joie, c’est-à-dire d’une augmentation de puissance.
Par conséquent, cultiver sa singularité consiste à développer toutes les aptitudes qui sont inhérentes à notre structure interne qui est animée par une dynamique positive et qui ne peut voir diminuer sa puissance que par l’action de facteurs externes qui viennent la déstructurer et qui produisent de la tristesse. Il faut donc faire en sorte que les conditions externes dans lesquelles nous évoluons soient favorables au développement de ces aptitudes créatives dans tous les domaines. Dans le domaine artistique, mais également sur le plan social, culturel, économique, technique, il faut que chacun prenne soin de sa créativité et de la créativité de l’autre pour que nous nous sentions pleinement exister en voyant notre puissance d’agir augmenter. Comme nous sommes des individus composés et composants (nous composons ces grands individus complexes que sont les sociétés humaines), comme nous sommes de singularités reliées, nous ne pouvons nous développer seuls. Il nous faut donc agir de manière à faire en sorte que la puissance d’agir des autres hommes augmentent, car cette augmentation de la puissance d’agir des autres et la condition de l’augmentation de la mienne et réciproquement. Si je suis entouré d’individus noyés dans la tristesse, l’expression de leurs passions tristes (la haine, l’envie, la jalousie, etc.) m’affaiblira nécessairement.
En revanche, une véritable culture de la joie ne peut que contribuer à l’expansion de la puissance de chacun. La puissance qui n’est pas le pouvoir, car le pouvoir peut lorsqu’il est exercé pour lui-même générer de la tristesse. En effet, le pouvoir (en latin potestas) renvoie à la capacité d’agir sur autrui et son exercice, lorsqu’il est le fait de personne animé par le goût du pouvoir – et c’est souvent le cas – s’avère le plus souvent un signe d’impuissance plutôt que la manifestation d’une réelle puissance. Lorsque le pouvoir n’est pas exercé pour lui-même, mais pour le bien d’autrui, il est une expression de la puissance d’agir de celui qui l’exerce. En revanche, lorsque le pouvoir est exercé pour lui-même, par goût du pouvoir, il est une marque d’impuissance, parce qu’il est le fait d’un être qui ne parvient pas à tirer sa force de ses propres ressources et qui, pour se sentir fort, ne voit pas d’autre moyen que de réduire la puissance de l’autre. C’est d’ailleurs à ce niveau que se situe la différence entre l’autorité et l’autoritarisme. L’autorité véritable consiste en l’exercice d’un pouvoir en vue du bien d’autrui, tandis que l’autoritarisme consiste dans l’exercice d’un pouvoir afin de satisfaire un désir de puissance inassouvi en soumettant l’autre. En un certain sens, celui qui exerce un pouvoir par goût du pouvoir ne parvient pas assumer à la fois sa singularité et celle de l’autre et ne peut se sentir singulier qu’en l’écrasant. Mais n’est-ce pas là une fausse singularité, une singularité mutilée et aliénée qui reste prisonnière de sa propre impuissance et qui confond singularité et culte de l’ego.
Car la singularité n’est pas culte du moi ou repli sur soi, elle est ouverture à l’autre pour accueillir sa singularité et mieux affirmer la sienne.
Il y a donc une dimension éthique à la culture de la singularité et une anthropologie de la singularité ne peut que déboucher sur l’émergence d’un éthos de la singularité. Savoir être singulier, c’est cultiver la puissance d’être soi en prenant soin de la puissance d’être soi de l’autre, c’est se créer chaque jour pour soi et pour autrui et offrir à l’autre une invitation à exprimer la créativité qui est en lui.
Eric Delassus