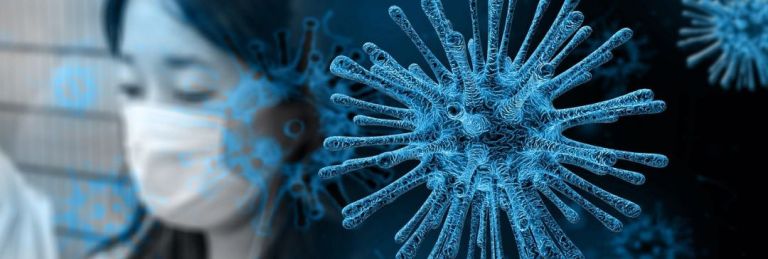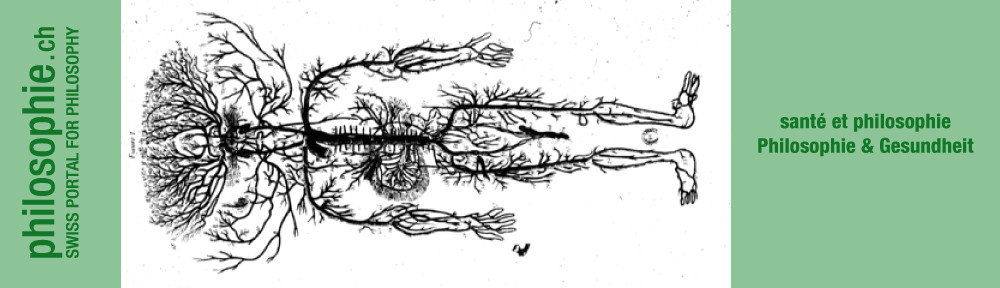Apprendre à être vulnérable
Posted in Articles on mai 31st, 2024 by admin – Commentaires fermésCommunication prononcée le 23/052024 dans le cadre du 11ème congrès de la Société de Philosophie des Sciences de Gestion qui s’est déroulé à l’ IAE Lille . Merci à Lidwine Maizeray , Fabrice Caudron, à tous les étudiants de l’I.A.E. et aux membres de la S.PS.G.pour l’organisation de ces journées enrichissantes et conviviales.
Apprendre à être vulnérable
Pourquoi devons-nous apprendre à être vulnérable ? Pas parce que nous ne le sommes pas, mais parce que nous ne savons pas l’être. Nombre de nos contemporains ont été éduqués avec l’idée qu’il ne faut pas montrer ses faiblesses, qu’il faut savoir se sortir seul des difficultés que la vie nous impose, qu’il faut être autonome et ne pas trop soucier du sort d’autrui parce que nous vivons dans un univers dans lequel nous sommes tous en concurrence et qu’il faut savoir lutter pour s’en sortir. Cette manière d’appréhender les choses, même si elle commence à être remise en question, est encore très présente dans le monde du travail et de l’entreprise.
Comme l’écrit Kevin André dans sa thèse consacrée à l’éthique du care dans l’enseignement en gestion :
L’attention sensible et empathique aux difficultés des autres est généralement considérée comme néfaste pour les affaires. On entend souvent que pour réussir dans les affaires, il vaut mieux être dur, rationnel et ne pas montrer ses émotions, encore moins prendre en compte celles des autres.
Cette vision des choses qui est induite par le régime économique et social dans lequel nous évoluons ne semble pourtant pas en adéquation avec ce qui fait notre humanité.
Apprendre à être vulnérable, cela ne signifie pas acquérir une qualité, une capacité ou une compétence, car vulnérable, nous le sommes et cette caractéristique constitue une dimension foncière de la condition humaine. Aussi, ce qu’il nous faut apprendre, ce qui nous manque, c’est plutôt de savoir être vulnérable, c’est-à-dire qu’il nous faut acquérir une certaine manière d’être qui s’appuie sur l’aptitude à assumer notre vulnérabilité. Le problème se situe, en effet, à ce niveau : nous sommes vulnérables, mais nous ne savons pas l’être parce que nous avons été éduqués pour nier cette vulnérabilité comme si le fait d’accepter celle-ci en augmentait la portée et les conséquences. Mais n’est-ce pas plutôt à la situation inverse que nous sommes confrontés ? N’est-ce pas plutôt le refus ou le déni de vulnérabilité qui nous rend plus fragiles et plus faibles ? Alors que consentir à notre vulnérabilité foncière pourrait nous permettre d’augmenter notre puissance d’agir pour mieux travailler en bonne intelligence les uns avec les autres.
Avant toute chose, il convient de définir plus précisément ce que nous entendons ici par vulnérabilité. En effet, « être vulnérable » signifie au sens littéral, être exposé à une possible altération, voire à la destruction de soi. Ainsi, certains animaux pendant la période de mue sont plus vulnérables puisqu’ils n’ont plus la protection naturelle qui leur permet de se protéger des prédateurs. Ils sont donc contraints à se cacher tant qu’ils n’ont pas renouvelé leur carapace parce qu’ils sont vulnérables.
Ce qui rend l’être humain vulnérable, c’est le fait qu’il ne peut vivre seul et qu’il ne peut se suffire à lui-même. En tant qu’animal social, et pour reprendre la fameuse formule d’Aristote, en tant qu’animal politique, c’est-à-dire en tant qu’animal social devant s’accorder avec ses semblables pour établir les règles qui vont régir les sociétés dans lesquelles il va vivre, chaque être humain dépend de tous les autres. Cependant, bien que foncièrement dépendants les uns des autres, nous baignons dans une culture qui fait l’éloge de l’autonomie, surtout d’une autonomie conçue sur le mode de l’indépendance, et qui nous incite à refouler notre vulnérabilité et ne la considérer que comme un caractère propre aux personnes déficientes. En effet, nous avons aujourd’hui tendance à ne considérer comme vulnérables que les personnes qui se trouvent dans une situation d’extrême dépendance, le nouveau-né, la personne âgée, malade ou en situation de précarité. De ce fait, nous excluons tous les autres êtres humains de la catégorie des personnes vulnérables. Comme si ces dernières n’étaient pas, elles aussi, en situation de dépendance.
Nous savons pourtant bien, au plus profond de nous-mêmes, qu’il n’en va pas ainsi et que nous avons tous besoin les uns des autres pour vivre. Pour reprendre la comparaison avec l’animal qui se protège grâce à sa carapace, nous pouvons dire que nous recourons tous à la présence et à l’action d’autrui pour former cette carapace sans laquelle nous serions en permanence exposés avec beaucoup plus de dureté aux difficultés de la vie.
C’est par l’entraide que les êtres humains parviennent à se maintenir en vie, même s’il est vrai également que leurs relations peuvent être fréquemment conflictuelles. Mais n’est-ce pas aussi pour répondre à cette conflictualité que nombre d’entre eux développent leur capacité d’entraide et prennent soin les uns des autres ? Il faut donc assumer sa vulnérabilité pour pouvoir y remédier par une assistance réciproque qui permet de vivre autant que possible en bonne intelligence les uns avec les autres.
Cette conception de la vulnérabilité comme dépendance a été principalement développée par les éthiques du care, ce mouvement philosophique venu initialement des États-Unis avec les travaux de Carol Gilligan – Une voix différente – ou de Joan Tronto – Un monde vulnérable.
Ainsi, Joan Tronto remet-elle en question une certaine conception de l’autonomie en prenant d’ailleurs un exemple emprunté à la vie d’une entreprise :
Un employé de bureau ne se sent pas vulnérable face à l’agent d’entretien qui, chaque jour, enlève les déchets et nettoie les bureaux. Mais si ces services devaient cesser, la vulnérabilité de l’employé se révélerait.
La question se pose donc de savoir pourquoi nous avons encore du mal à assumer notre vulnérabilité et pourquoi il nous faut apprendre à être vulnérable. Une explication possible de cette situation pourrait venir de la manière dont s’est constituée notre modernité.
En effet, cette dernière s’est essentiellement bâtie sur l’idée d’autonomie.
Cette évolution a incontestablement joué un rôle émancipateur dans l’histoire humaine dans la mesure où elle a permis aux êtres humains de se détacher de leur assujettissement face à de nombreux pouvoirs qui s’exerçaient de telle sorte qu’ils maintenaient la majorité des hommes dans la minorité et la soumission. Cependant, si ce progrès vers l’autonomie, dont Kant fut l’un des promoteurs par son fameux texte Qu’est-ce que les Lumières ?, a permis une avancée considérable dans la marche vers une plus grande liberté, il a également donné lieu à l’occultation d’une dimension essentielle de la condition humaine qui est la vulnérabilité.
En effet, cette promotion de l’autonomie individuelle, en mettant fin à juste titre à de nombreuses formes de dépendances qui étaient de l’ordre de la soumission, nous a conduit à négliger d’autres formes de dépendances qui donnent lieu à des comportements et des conduites qui sont plutôt de l’ordre de l’entraide, de la solidarité et de l’attention accordée à autrui comme à soi-même. C’est ce caractère foncier de la condition humaine qui a été mis en lumière par les éthiques du care qui insistent sur l’importance à accorder à certains sentiments moraux comme la sollicitude ou l’empathie que les théories morales fondées sur l’autonomie – et l’on retrouve à nouveau ici la pensée kantienne – ont eu tendance à mettre de côté, voire à rejeter, sous prétexte que les sentiments ne pouvaient nous orienter de manière fiable vers une attitude authentiquement morale, tandis qu’une approche plus « rationnelle » conduirait à l’observation de règles universelles et nécessaires.
Cette manière d’appréhender la condition humaine s’est également traduite sur le plan politique avec les théories du contrat qui ont pensé la constitution des sociétés sous la forme d’un engagement mutuelle et réciproque des individus les uns envers les autres. Approche que l’on retrouve chez certains penseurs du XXe siècle comme John Rawls dans sa Théorie de la justice. Or, ce qu’ont mis en avant les éthiques du care, c’est le fait que les êtres humains sont dépendants les uns des autres, ainsi que de leur environnement, et qu’en ce sens, ils sont vulnérables et d’autant plus vulnérables qu’ils n’assument pas ou qu’ils nient cette vulnérabilité. Cela fait, qu’aussi paradoxal que cela puisse paraître, la promotion de la notion d’autonomie, dont la fonction était de rendre les hommes plus libres, a eu pour conséquence de produire de nouvelles formes d’aliénation et a fait de l’être humain « le tyran de lui-même et de la nature » pour reprendre l’expression utilisée par Jean-Jacques Rousseau dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.
Cela s’est traduit dans le monde du travail par ce que l’on pourrait appeler un passage de la servitude à l’aliénation avec la naissance du salariat qui se base sur des liens contractuels supposant des sujets contractants libres et égaux, c’est-à-dire autonomes. Ce qui n’a pas fait obstacle à la naissance du taylorisme dans la mesure où l’on considérait que l’ouvrier avait choisi librement ses conditions de travail en s’engageant librement envers l’employeur.
Cette perception de l’être humain comme un être par définition autonome est aussi à l’origine des problèmes environnementaux qu’il n’est pas possible de dissocier totalement des tensions sociales et des rapports de domination qui structurent le monde du travail. L’être humain, en se percevant « dans la nature, comme un empire dans un empire » [Spinoza], a objectivé celle-ci au point d’oublier qu’il en faisait partie et qu’il en était dépendant. Ainsi, une fois de plus en occultant certaines dépendances et en niant sa vulnérabilité, il s’est rendu d’autant plus vulnérable.
Il semble donc urgent de changer de paradigmes pour construire le monde de demain, si l’on veut que celui-ci soit plus juste et plus durable, si l’on aspire à un monde plus humain, non pas au sens où l’être humain s’imaginerait être en son centre, mais au sens où il vivrait en n’oubliant pas les liens qui constituent son humanité. Il nous faut donc apprendre à être vulnérable, apprendre à assumer notre vulnérabilité pour faire en sorte que l’on puisse un jour habiter un monde – et c’est là le véritable sens de l’éthique – dans lequel chacun se percevra comme une personne vulnérable collaborant avec d’autres personnes vulnérables.
Cet apprentissage nécessite donc une prise de conscience à laquelle seule l’expérience [J. Dewey] peut nous permettre d’accéder par la perception des conséquences néfastes pour l’humanité d’une telle vision de la place de l’être humain dans le monde. Ainsi, l’exemple cité plus haut et emprunté à Joan Tronto montre bien en quoi l’expérience de l’absence de l’autre dont nous avons besoin pour agir, pour vivre et travailler, peut être une manière d’apprendre la vulnérabilité en découvrant notre dépendance. Et le mot découvrir est ici à prendre dans son sens littéral, car le plus souvent, notre vulnérabilité est recouverte par un voile qui rend invisibles nos dépendances. Nous pouvons ainsi constater que le plus souvent les agents d’entretien qui contribuent à faire en sorte que nous puissions travailler dans des conditions satisfaisantes font partie de ces travailleurs invisibles qui œuvrent la nuit sans que l’on puisse jamais les croiser et reconnaître la valeur de leur travail. C’est d’ailleurs souvent la condition des travailleurs du care, ceux qui prennent soin des autres et qui sont les plus indispensables (ce sont principalement ceux qui ont continué à travailler durant le confinement). C’est pourquoi, il serait salutaire de généraliser autant que faire se peut les initiatives de certaines entreprises qui font en sorte que l’entretien des locaux soit effectué pendant les heures de travail des autres employés, afin que chacun prenne la mesure de l’importance de ce travail et fasse l’expérience de la vulnérabilité.
Cette expérience de la vulnérabilité, parce qu’elle est expérience de la dépendance, doit être menée de telle sorte qu’elle donne lieu à un travail sur les affects. En effet, nous ne sommes pas seulement vulnérables parce que nous sommes dépendants les uns des autres, nous le sommes également parce que nous sommes dépendants de tout un environnement aussi bien matériel que psychologique qui exerce une action sur nous et nous modifie – c’est d’ailleurs là le premier sens du verbe affecter. Parce que tout ce qui nous environne nous modifie, nous devons être à l’écoute de nos affects, des nôtres et de ceux d’autrui, afin d’en dégager ce qu’ils peuvent nous apprendre de notre condition. Nous avons trop longtemps été habitués à étouffer nos affects et à les faire taire pour laisser la place à une rationalité qui se prétend objective. Cependant, comme l’avait déjà démontré Spinoza et comme cela est aujourd’hui avéré par les travaux de certains spécialistes des neurosciences comme Antonio Damasio, qui se réclame d’ailleurs de Spinoza, une raison totalement désincarnée et coupée des affects ne produit rien de très raisonnable et donne plutôt lieu à une certaine forme de déshumanisation. Les méthodes de management se prétendant scientifique comme le taylorisme se targuent d’être rationnelles, on peut néanmoins s’interroger sur leur caractère raisonnable. Il est donc temps de prendre conscience de la manière dont nous sommes affectés et dont nous affectons le monde qui nous entoure pour mettre en place une dynamique de réelle bienveillance au cœur des entreprises et des organisations.
Pour que cette expérience puisse donner lieu à une démarche réflexive permettant de développer une plus grande empathie de la part des managers, il serait peut-être judicieux de mettre en place au cours de leur formation une initiation à la démarche narrative de manière à pouvoir, en faisant le récit d’expérience vécue lors de période d’immersion dans le monde de l’entreprise, prendre conscience de leur vulnérabilité ainsi que de celle de ceux qu’ils devront accompagner lorsqu’ils seront pleinement insérés dans la vie professionnelle. Apprendre à se raconter et à écouter et interpréter le récit de l’autre, ainsi qu’apprendre à traiter les affects qu’engendrent ces récits pourrait donner lieu à une prise de conscience permettant de mieux prendre en charge la vulnérabilité humaine dans le monde de l’entreprise.
Cette prise de conscience s’est déjà produite chez certains entrepreneurs qui, en s’inscrivant dans le courant des entreprises à impact ou des entreprises à mission, s’efforce de contribuer à l’édification d’un monde du travail plus respectueux de la personne humaine et de l’environnement. Ces entreprises contribuent donc d’une certaine manière à l’apprentissage de la vulnérabilité dans la mesure où elles peuvent exercer une fonction d’exemplarité en montrant qu’un autre monde est possible, un monde où le travail fait réellement sens parce qu’il ne consiste plus à exploiter les hommes et la nature pour en tirer un profit excessif, mais à privilégier le « travailler dans » et le « travailler avec » par rapport au « travailler sur » qui est trop souvent oublieux de son impact humain et environnemental.
Apprendre à être vulnérable consiste donc également à apprendre à collaborer, apprendre à travailler avec ses semblables dans un environnement que l’on préserve et que l’on s’efforce de réparer (cf. Les travaux de Joan Tronto et ceux de Corine Pelluchon). Cela suppose donc que l’on apprenne à percevoir le travail autrement, sur le mode du care, c’est-à-dire de l’utilité réciproque. Travailler ce n’est pas simplement gagner sa vie ou viser le profit comme une finalité, c’est d’abord produire des biens et des services utiles aux autres, c’est-à-dire pour parler comme Spinoza susceptible d’augmenter leur puissance d’agir. En ce sens, le travail peut s’inscrire dans une démarche proche de celle du care telle qu’elle est définie par Joan Tronto :
Une activité caractéristique de l’espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre «monde» de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités (selves) et notre environnement, que nous cherchons à tisser ensemble dans un maillage complexe qui soutient la vie.
Ainsi, pourrons-nous peut-être vaincre l’hubris auquel nous a conduit le culte de l’autonomie humaine qui nous a fait perdre de vue les dépendances qui nous construisent et élaborer une nouvelle forme d’autonomie. Il faudrait donc passer de l’autonomie-indépendance à une autonomie plus solidaire, une autonomie fondée sur l’intelligence de la dépendance réciproque ne réduisant pas l’être humain à une individualité séparée, mais intégrant des notions comme celles d’entraide et de sollicitude.
Éric Delassus