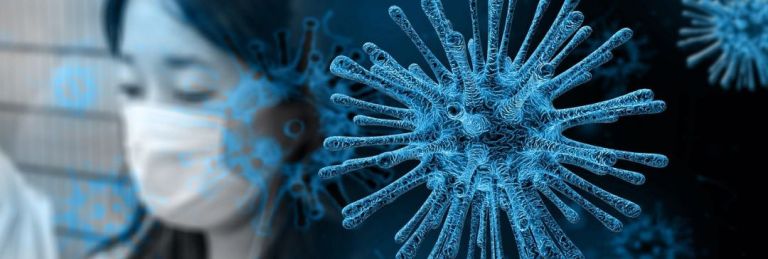Est-il pertinent d’opposer ce qui est naturel et ce qui ne l’est pas ?
Posted in Articles on juin 13th, 2022 by admin – Commentaires fermésNous sommes habitués à opposer ce qui est naturel et ce qui ne l’est pas. On peut d’ailleurs faire remonter cette tendance à Aristote qui dès les premières pages de sa Physique distingue les choses qui existent par nature de celles qui existent par d’autres causes et qu’il qualifie de « produits de l’art », sous-entendant par là que ce qui est produit par l’activité de l’homme n’est pas vraiment naturel, comme si l’homme n’était pas partie prenante de la nature et ne pouvait pas jouer le rôle d’une cause naturelle dans les transformations qu’il produit sur son milieu. Cette distinction a aussi conduit à faire de la nature, ou plus exactement de ce que nous appelons ainsi, une norme et une valeur. Cela a pu donner lieu à des dérives comme la condamnation de certains comportements ou de certains caractères considérés comme déviants. N’a-t-on pas condamné l’homosexualité sous prétexte qu’elle ne serait pas naturelle ?
Mais cette distinction a-t-elle un sens ? Ne serait-il pas plus judicieux de considérer qu’à partir du moment où une chose est possible, elle est naturelle au sens où les lois de la nature n’entrent pas en contradiction avec sa réalisation ? Néanmoins, dans ces conditions, dire qu’une chose est naturelle ne signifie pas qu’elle est nécessairement bonne pour tous les éléments qui composent ce que nous appelons la nature. Ainsi, la nature produit des virus qui ne sont pas bons pour ceux qu’ils infectent et au dépens desquels ils se développent.
De plus, cette distinction entre ce qui est naturel et ce qui ne l’est pas, n’est-elle pas à l’origine des problèmes environnementaux que nous connaissons aujourd’hui ?
D’où vient-elle en effet ? De ce que l’être humain, parce qu’il est doué de conscience a pris, principalement dans la civilisation occidentale, ses distances relativement à ce qu’il appelle le monde extérieur et de là est née la distinction sujet / objet. L’être humain se perçoit alors comme « sujet », celui qui agit, et il considère la nature comme son autre, comme son objet –ce qui est jeté devant lui – qui doit subir son action. C’est ainsi que nous avons oublié cette donnée que nous a fort heureusement rappelé Spinoza au XVIIe siècle, mais dont nous n’avons pas encore saisi toute la portée, c’est-à-dire que l’’être humain n’est pas dans la nature « comme un empire dans un empire ». L’être humain n’est pas dans la nature comme un état dans l’état, il n’est pas régi par d’autres lois que celles de la nature elle-même, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a pu agir sur celle-ci au point de produire cette nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes tristement entrés et que certains scientifiques ont appelé anthropocène. L’homme agit comme une cause naturelle sur la nature au point d’en modifier l’évolution au même titre que les forces telluriques ou astronomiques. Cela dit, ce n’est pas parce que l’être humain est une force naturelle que tout ce qu’il fait est bon pour lui et pour les autres vivants auxquels il est indissociablement lié. Au même titre que la collusion d’une météorite avec notre planète pourrait détruire toute forme de vie, les erreurs qu’a pu commettre l’humanité sur le plan technique et technologique pourraient très bien remettre en question, sinon la présence de toute vie sur terre, en tout cas celle de la vie humaine de nombreuses autres formes qu’elle peut prendre. Aussi, puisque son action sur son environnement est consciente, est-il de son devoir, s’il veut préserver les conditions d’une vie valant la peine d’être vécue sur cette planète, qu’il se soucie des conséquences de ses actes et qu’il prenne conscience de la solidarité qui l’unit aux autres vivants.
C’est précisément parce qu’ils ont distingué le naturel du non-naturel que certains êtres humains se sont perçus comme étrangers à la nature et se sont imaginés qu’ils pouvaient la considérer comme un réservoir de ressources inépuisables, sans avoir à subir les conséquences de leurs actions sur celle-ci.
Cessons donc d’opposer ce qui est naturel et ce qui ne l’est pas, cessons de nous penser comme en-dehors de la nature et d’adopter une position de surplomb relativement à l’univers dont nous faisons partie et prenons ainsi conscience de notre responsabilité devant tous les vivants et principalement envers les générations futures auxquelles nous allons léguer ce monde.
Éric Delassus