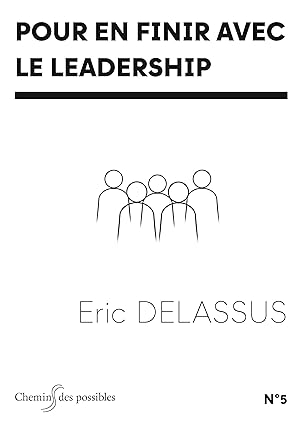…c’est une œuvre qui n’est pas aisée que de déterminer avec précision à l’avance, comment, contre qui, pour quels motifs, pour combien de temps, il convient de se mettre en colère ; car tantôt nous devons louer ceux qui restent en deçà et s’abstiennent, et nous disons qu’ils sont pleins de douceur ; tantôt nous ne louons pas moins ceux qui s’emportent, et nous leur trouvons une mâle fermeté. (Aristote, Éthique à Nicomaque).
Un adage prétend que la colère est mauvaise conseillère. Cela est souvent vrai.
La colère, généralement, obscurcit notre jugement. Elle appartient à cette catégorie d’affect que la philosophie classique désigne par le terme de passion. Comme son nom l’indique, une passion nous rend passifs, elle est tout le contraire de l’action. Lorsque nous sommes sous l’emprise d’une passion, nous subissons les effets de facteurs extérieurs sur notre manière de percevoir le monde et nous perdons toute forme de lucidité. Nous n’interprétons plus les événements que nous vivons qu’au travers du prisme de cette passion. Ainsi en va-t-il de la colère. La colère est une variante de la haine, ce sentiment que nous ressentons envers les choses que nous percevons comme nous étant nuisibles. Lorsqu’elle s’empare de nous, nous sommes animés par le violent désir de détruire ces choses, de les anéantir pour mettre fin au mal qu’elles nous causent.
Ainsi, sous l’emprise de la colère, nous sommes incapables de faire preuve d’indulgence, nous sommes dans l’impossibilité d’analyser une situation avec lucidité. Nous ne sommes animés que par l’envie irrépressible d’écraser ce qui nous dérange, ce qui nous fait souffrir, ce qui nuit à la réalisation de nos projets. Parfois, cette nuisance est réelle, mais parfois aussi, elle n’est que le fruit de notre imagination et résulte avant tout d’une erreur de jugement. Nous pouvons, par exemple, voir un ennemi dans l’ami qui veut nous éviter de nous fourvoyer et nous met face à nos erreurs. Nous croyons qu’il s’interpose comme un obstacle entre nos intentions et leur aboutissement, alors qu’en réalité, il ne fait que nous mettre en garde contre un éventuel échec. Il est donc toujours préférable d’attendre que la colère soit apaisée avant de prendre une décision.
Est-ce à dire que, pour autant, il ne faille jamais se mettre en colère ? Est-il toujours judicieux de rester impassible face aux événements et principalement face aux comportements qui peuvent porter atteinte à la dignité humaine ? Doit-on rester indifférent aux insultes et aux humiliations sans répliquer, sans manifester avec véhémence son indignation ?
C’est ici qu’il faut distinguer « colère chaude » et « colère froide ». La colère, telle que nous venons de la décrire, la colère qui s’empare de nous et que nous ne parvenons pas à modérer, s’apparente à ce que l’on peut qualifier de colère chaude. Elle se déclenche comme un embrasement soudain attisé par le vent de la haine et que nul ne parvient à éteindre. Il n’y a alors pas d’autres solutions que d’attendre la fin de la tempête. En revanche, la colère froide concerne la colère maîtrisée, une colère qui sait se modérer et se tenir dans des limites du raisonnable, mais qui sait aussi laisser son empreinte dans l’esprit de ceux contre qui elle se déclenche. Son but n’est pas de détruire ce qu’elle vise. Elle ne s’adresse pas tant aux personnes qu’à leur manière d’être, elle se déclenche plus contre des comportements que contre des individus. En ce sens, elle peut souvent être qualifiée de colère juste. Cette colère ne s’empare pas de celui qui la ressent, il en est l’auteur. Il convient d’ailleurs, sur ce point précis, d’opérer une nouvelle distinction. Il ne faut pas confondre « être sous l’emprise de la colère » et « se mettre en colère », dans le premier cas la colère est une pure passion, dans le second elle contient des éléments actifs qui en font un affect salutaire. La colère froide est une colère réfléchie. On pourrait voir dans cette expression un oxymore, mais il n’en est rien. La colère froide n’est pas une colère feinte, elle est bien réelle et relève d’une certaine capacité d’autoaffection de l’être humain, d’une aptitude à produire en soi certains affects tout en les maîtrisant à la manière dont un cocher retient son attelage, le laissant galoper sans qu’il s’emballe. La colère froide peut être comparée à un cheval fougueux qu’un cocher habile maintient dans les limites du sentier qu’il emprunte.
Elle relève de ce qu’Aristote appelle le juste-milieu, cette médiété qui n’a rien à voir avec de la tiédeur, mais qui désigne la juste mesure entre l’excès et le défaut.
Ainsi, face à l’insulte ou l’humiliation, la passivité peut relever de la lâcheté ou d’une absence de respect de soi, mais la colère violente et incontrôlée ne peut être que le fait d’une brute, d’une personne irréfléchie et irascible. En revanche, la colère froide, celle qui a pour but d’exprimer l’indignation et de souligner la bassesse de celui envers qui elle est destinée, est plutôt un signe de courage, une manifestation de l’estime que l’on se porte à soi-même en tant qu’être humain. Elle se manifeste donc au nom de l’humanité qui est en chacun de nous.
Mais comme le précise Aristote dans Éthique à Nicomaque, il faut savoir se mettre en colère au moment qui convient -le kairos, le moment opportun – et durant le temps qui convient, afin, comme on dit, de « marquer le coup », de montrer à celui qui nous agresse que l’on n’est pas disposé à se laisser faire, mais que l’on est également capable d’indulgence, si ce dernier revient à de meilleurs sentiments.
Cette colère est celle d’un homme sage. La sagesse dont il est ici question n’est pas la sophia des Grecs qui désigne la science qui concerne la connaissance du général, mais le phronesis, terme qui, selon les traductions, peut désigner la prudence ou la sagacité. Il s’agit d’une certaine capacité de l’esprit à appréhender le singulier, c’est-à-dire ce qui n’a pas son pareil, ce qui ne se produit qu’une fois, ce à propos de quoi on ne peut établir de règle générale. C’est pourquoi, il importe de distinguer le singulier du particulier. Dans un ensemble, tous les éléments sont particuliers, mais ils ne sont pas nécessairement singuliers, car ils peuvent être tous identiques. En revanche, dans un groupe humain, tous les individus qui le composent sont des personnes singulières, c’est-à-dire ayant chacune une identité propre. Dans un tel groupe, aucun individu ne peut être substitué à un autre, chacun d’eux est, dans une certaine mesure, irremplaçable.
Ainsi en va-t-il des relations humaines. Elles concernent toujours des individus singuliers entre lesquels s’établissent des relations singulières. Il faut donc savoir appréhender ces singularités pour adopter face à elles l’attitude, elle-même singulière, qui convient.
Il est donc parfois bon de se mettre en colère, d’une colère froide et réfléchie, mais non-feinte. D’une colère qui permet « de remettre les choses à leur place », de montrer que l’on ne capitule pas devant la violence des gestes ou des mots, d’une colère mesurée par laquelle on manifeste sa dignité d’être humain.
Éric Delassus