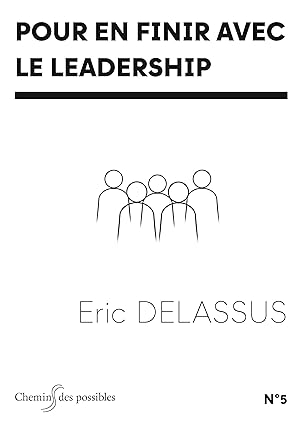Conférence prononcée le 29 mai 2024 au CHU de Reims lors la deuxième édition des rencontres de l’encadrement proposées par la Direction des Ressources Humaines et la Direction des Soins Infirmiers et de Rééducation et Médico-techniques. Merci à THIERRY BRUGEAT, Jeannine Leonard, Capucine Gremion, Isabelle Daligault, Sandrine COURROUX, Yannick BOMY, Axelle Bringard, Elodie Garin et Carole Etiennot de m’avoir invité à participer à cette journée.
Il y a quelques années des jeunes étudiants d’une école prestigieuse ont, lors de la cérémonie de remise des diplômes, remis publiquement en question les principes en fonction desquels ils avaient été formés durant leur cursus.
On peut trouver incongru ou déplacé la manière dont s’est manifestée cette remise en question, mais indépendamment de tout jugement de valeur, cette attitude est significative d’une aspiration qui anime une grande partie de notre jeunesse qui cherche à redonner du sens au travail et qui considère que cette activité ne peut se réduire à gagner, voire à bien gagner sa vie. Pour beaucoup de nos contemporains, le travail n’est plus en lui-même une valeur, il est plutôt appréhendé comme l’activité qui ne prend tout son sens que si elle contribue à promouvoir les valeurs dans lesquelles on se reconnaît. Certes, pour encore de trop nombreuses personnes, le travail n’est avant tout que le seul moyen de gagner péniblement sa vie en exerçant une activité que l’on n’a pas nécessairement choisie. Pour d’autres qui ont la possibilité de choisir le métier qu’ils vont exercer, la seule valeur qui les intéresse est l’argent et le profit à court terme. Néanmoins, pour une certaine frange de la jeunesse qui a apparemment tendance à augmenter considérablement, l’existence humaine est riche de bien autre chose et elle doit prendre un sens qui dépasse les intérêts égoïstes et c’est cela qui les motive. Aussi, dans la mesure où le travail est une activité qui occupe une bonne partie de notre vie, il importe que le sens que nous lui trouvons permettent le plein épanouissement de ce qui fait notre humanité.
L’être humain est, en effet, en quête de sens. S’il ne perçoit pas le sens ce qu’il fait, de ce qu’il vit, il dépérit, il ressent un sentiment de vide et a l’impression qu’il perd quelque chose d’essentiel de son humanité. Or, le travail étant une activité difficile, parfois pénible, ingrate et qui, comme on vient de le dire, occupe la majeure partie de notre existence, il est absolument nécessaire qu’il prenne sens pour que nous puissions trouver en nous l’énergie nécessaire pour l’exercer. Si la rémunération est un élément non-négligeable de la motivation au travail, il est clair qu’elle ne suffit pas pour répondre à toutes les aspirations de l’être humain. On peut très bien recevoir un salaire conséquent, ne pas rencontrer de difficultés insurmontables dans l’effectuation des missions que l’on doit remplir et se trouver en situation de détresse et de souffrance au travail, tout simplement parce que l’on ne perçoit plus le sens de ce que l’on fait. C’est ce qu’a magistralement montré le regretté David Graeber dans son fameux livre sur les bullshit-jobs – « les boulots à la con » -, c’est-à-dire ces métiers souvent bien payés, mais qui ne servent à rien et qui donnent l’impression à ceux qui les exercent que le monde tournerait tout aussi bien – ou tout aussi mal – s’il n’avait rien fait. C’est par exemple le lot de ceux à qui l’on demande la rédaction de rapports longs et fastidieux qui, à peine terminés, sont immédiatement archivés sans être lus. On comprend bien le sentiment d’absurdité que doivent ressentir ceux qui sont chargés de telles missions. L’absence de sens leur donne l’impression d’un vide sidéral dans lequel ils ont le sentiment de s’enfoncer et finalement de se dissoudre. Le sens est donc l’un des aliments essentiels de l’être humain, il est aussi nécessaire à notre survie que les aliments que nous mangeons, l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons.
Mais que faut-il mettre derrière cette notion de sens ?
Avant d’aborder la question du sens du travail, il importe peut-être de s’interroger tout d’abord sur le sens du sens.
On peut retenir au moins, trois acceptions, trois usages possibles du terme de sens :
Les cinq sens
La direction
La signification
On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons pour lesquelles ce même mot désigne trois choses apparemment aussi différentes. Que peut-il bien y avoir de commun entre elles pour qu’on en arrive à les désigner par le même terme ?
Si nous les prenons un à un et que nous les définissons successivement, nous pouvons mieux percevoir ce qui les réunit.
- Les cinq sens nous permettent d’entrer en relation avec le monde extérieur et aussi d’ailleurs avec nous-mêmes puisque notre corps se perçoit lui-même de manière sensible.
- La direction désigne la relation entre deux points dans l’espace, un point initial et un point d’arrivée.
- Quant à la signification elle désigne la relation entre un signe et ce qu’il désigne ou plus exactement, pour parler comme les linguistes, entre un signifiant et un signifié.
Ainsi, si l’on passe en revue ces trois usages du mot sens, on s’aperçoit qu’ils sont réunis par l’idée de relation. Et, en effet, pour qu’une chose prenne sens, il faut toujours qu’elle entre en relation avec autre chose qu’elle-même ou qu’elle soit en capacité d’entrer en relation avec elle-même. C’est l’une des raisons pour laquelle la notion de sens joue un rôle fondamental dans l’existence humaine, car le degré de conscience de soi de l’être humain est tel qu’il est capable d’établir avec lui-même, les autres et le monde qui l’entoure une relation riche et complexe.
De plus, parce qu’il est conscient, l’être humain est également un être de désir. Il n’a pas seulement des besoins qui sont principalement l’expression d’une nécessité biologique, il a aussi des désirs qui obéissent à un autre type de nécessité. On ne peut pas dire, en effet que le désir aspire à quelque chose de superflu, il obéit plutôt à une nécessité dont on pourrait dire, pour faire bref, qu’elle est de nature psychologique. Le désir est selon Spinoza « l’essence de l’homme », ce qui veut dire que nous sommes avant tout désir et que ce à quoi nous accordons de la valeur pour donner du sens à notre existence, c’est ce que nous désirons. Et le travail, aussi paradoxal que cela puisse sembler peut répondre à notre désir, si précisément, il correspond à une activité qui a suffisamment de sens pour cela.
Comme cela a déjà été évoqué, le travail n’est pas en lui-même une valeur, on ne cherche pas à travailler pour travailler. Le travail n’est pas une fin en soi, il est essentiellement un moyen. Il n’est pas une valeur, mais un moyen de produire de la valeur, de réaliser des choses auxquelles nous allons accorder plus ou moins de valeur.
Selon la philosophe Hannah Arendt, le travail n’est pas une activité par laquelle nous accomplissons pleinement notre humanité dans la mesure où il est encore attaché à notre condition animale étant donné que la plupart des choses que nous produisons par le travail sont destinées à être consommées, c’est-à-dire détruites. Vu sous cet angle, le travail ne répondrait qu’à un besoin. En revanche, une activité ne devient vraiment humaine selon Harendt que lorsque ce qu’elle produit est appelé à durer et dans ce cas, on n’est plus vraiment dans le travail, mais dans l’œuvre. Par conséquent, il me semble que pour que le travail prenne sens, pour qu’il prenne un sens suffisant pour donner du sens à l’existence, il faut qu’il dépasse la seule satisfaction des besoins et qu’il soit l’occasion de créer un certain type de lien avec le monde et avec les autres qui soit suffisamment riche pour que celui qui travaille n’ait pas le sentiment de perdre sa vie à la gagner. Ce fameux slogan du mouvement de mai 68 est intéressant dans la mesure où il joue sur les deux sens du mot vie, d’un côté la vie comme existence et de l’autre la vie au sens biologique. En effet, si je ne travaille que pour obtenir ce qui est nécessaire à ma survie, le sens de mon existence est d’une grande pauvreté et ne permet pas de répondre à des aspirations pleinement humaines. C’est d’ailleurs en ce sens que Marx considérait qu’il y avait quelque chose d’inhumain dans la condition ouvrière du XIXe siècle, puisque le travailleur était utilisé comme une simple force mécanique et n’avait comme seule rémunération que ce qui lui permettait de renouveler sa force de travail. Sous cette forme, le travail est, en effet, pauvre en sens et correspond à l’une de ses significations étymologique possible qui est le trepalium, cet instrument de torture sur lequel on attachait le supplicié. Si ce type de travail est une souffrance, ce n’est pas seulement parce qu’il est pénible, – tout travail, même celui que j’ai choisi et que j’aime, nécessite un effort et de la peine – mais surtout parce qu’il est subi. Or, ce à quoi tout être humain aspire, c’est à être actif, c’est-à-dire à être l’auteur, au moins partiellement, de ce qu’il fait et plus il perçoit le sens de l’activité qu’il exerce, plus il se sent acteur de son travail.
Seulement, parfois, ce sens n’apparaît pas immédiatement et c’est alors à ceux qui exercent des fonctions de management de le révéler. À ce sujet, je soulignerai d’ailleurs que le rôle du manager n’est pas de donner du sens au travail, ce qui sous-entendrait que le travail n’a pas initialement de sens et qu’il faut ensuite lui en donner un. Certes, il peut y avoir des métiers absurdes – les bullshit-jobs dont parle David Graeber (ex. De la fourmi qui travaille et fait vivre 10 personnes qui ne servent à rien) -, mais si une profession n’a pas de sens, celui qu’on lui donnera ne sera qu’apparent et artificiel. En revanche, un métier peut avoir un sens qui n’est pas immédiatement perçu ou perceptible et l’on s’aperçoit que lorsque ce sens apparaît, il est exercé plus efficacement. Pour illustrer cela je prendrai un exemple que j’emprunte au livre Déclic d’Hélène et Philippe Korda.
Il s’agit d’un expérience qui a eu lieu aux États-Unis États-unis auprès d’étudiants travaillant dans un centre d’appel destiné à contacter d’anciens élèves de l’Université du Michigan en vue de collecter des dons pour financer les études de jeunes issus de milieux défavorisés. En raison d’un nombre croissant de refus de dons, les opérateurs se démotivent et deviennent de moins en moins convaincants, ce qui augmente le nombre de refus. Pour sortir de ce cercle vicieux les dirigeant de cet organisme font appel au psychologue Adam Grant, alors doctorant en psychologie, pour trouver le moyen de remotiver le personnel. Tout a été essayé, et même ce qui touche à la rémunération n’aboutit pas à une amélioration des résultats. Grant décide donc de diviser les opérateurs en trois groupes et propose que l’on propose à chacun des groupes de lire un court texte avant de se mettre au travail. Le premier groupe lira un texte extrait d’un manuel de chimie, le second groupe un texte expliquant les bénéfices personnels que pourront tirer les opérateurs de leur travail. À l’issue de cette journée, les résultats des deux premiers groupes n’ont absolument pas augmenté. En revanche, il va tout autrement du troisième groupe auquel il a été demandé de lire un texte dans lequel un ancien étudiant raconte de manière poignante comment, après que ses parents lui aient annoncé qu’ils ne pourraient pas lui payer des études à l’université du Michigan, il a découvert qu’il pouvait bénéficier d’une bourse, ce qui a totalement changé sa vie. Pour ce dernier groupe, les résultats sont deux fois et demi supérieurs à la moyenne. Pour aller plus loin Grant demande à l’ancien étudiant de venir en personne raconter son histoire. Après cette séance, les performances sont multipliées par quatre. Ensuite, pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une réaction ponctuelle liée à l’émotion, mais qui pourrait ne pas durer, Grant continue de mesurer les performances à plus long terme et s’aperçoit qu’elles ne varient plus. Le déclic s’est produit et ses conséquences s’inscrivent dans la durée.
Cette expérience nous apprend deux choses. D’une part, elle nous enseigne que ce n’est pas l’intérêt personnel qui est le facteur de motivation principal. Ici, c’est en comprenant l’impact qu’un travail peut avoir sur la vie d’autrui que les motivations se sont renforcées. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que la rémunération est un facteur négligeable, elle participe de la reconnaissance à laquelle aspire le travailleur et en bonne justice, il est absolument nécessaire que le travailleur soit rémunéré à la mesure de ses efforts. D’autre part, le second enseignement de cette expérience concerne la manière dont le sens apparaît. En effet, ce n’est pas parce que quelqu’un a indiqué aux employés le sens de leur travail que leur motivation s’est accrue, mais c’est plutôt parce qu’en leur permettant de découvrir l’impact réel qu’il peut avoir sur la vie des gens qui en bénéficient, ils ont pu construire par eux-mêmes ce sens et se l’approprier.
Ce que l’on peut voir ici, c’est que le sens se révèle à travers le vécu des uns et des autres et que lorsqu’il est perçu, il renforce le désir de parvenir au résultat que l’on vise.
Comme cela a été souligné précédemment, le sens s’inscrit toujours dans un tissu relationnel et ce que met en évidence cette expérience, c’est que lorsque les personnes qui travaillent dans un domaine parviennent à percevoir la trame de ce tissu, elles se sentent plus motivées et leur désir de bien faire s’en trouve augmenté.
Cette question du désir est réellement au cœur d’une réflexion sur le sens du travail, car si nous ne désirons pas spontanément travailler, le travail peut être l’occasion pour le désir humain de s’affirmer et de se déployer. Le travail peut aussi, bien entendu, être à l’origine d’un étouffement du désir, tout cela dépend de son organisation et de la manière dont il est pratiqué.
Le désir peut être considéré comme le moteur de la vie humaine et pour bien comprendre en quoi il consiste, il suffit de procéder à une expérience de pensée assez simple.
Imaginez qu’un matin vous réveillez sans ressentir aucun désir, pas même celui d’aller vous faire un thé ou un café. Rien ! Cet état à un nom, il se nomme la dépression et il est à l’origine pour ceux et celles qui le vivent d’une intolérable souffrance. Ce que nous apprend cette expérience, c’est que sans désir, il n’y a pas de vie possible. Le désir est le moteur de la vie humaine. Il est la puissance par laquelle nous nous maintenons en vie, pensons et agissons. En ce sens, il est probablement pour l’être humain plus fondamental que le besoin, car s’il disparaît, nous n’avons même plus la force de répondre aux nécessités de la vie. À l’inverse, nous pouvons parfois renoncer à la satisfaction de certains besoins pour satisfaire notre désir. On peut, par exemple se référer aux sacrifices que peuvent faire certains artistes pour parvenir à créer une œuvre.
S’il en va ainsi, c’est que le désir est puissance, puissance d’être, puissance d’agir et de penser. Il est en certain sens une puissance qui vise à augmenter sans cesse et c’est d’ailleurs pourquoi il est source de joie au sens où l’entend Spinoza, c’est-à-dire d’un affect qui exprime une augmentation de puissance. Il faut ici être attentif à ne pas confondre la puissance et le pouvoir, il ne s’agit pas d’exercer une domination sur autrui, mais principalement d’être en mesure d’agir pour se sentir exister et obtenir la reconnaissance d’autrui.
Agir signifie au sens strict produire un effet, être cause d’une modification du monde extérieur et cela est pour l’être humain essentiel, car ce que nous réalisons se présente à nous comme une preuve objective de notre existence. C’est le philosophe allemand Hegel qui a mis ce processus en évidence. Il souligne que l’être humain ne peut se contenter d’une impression subjective d’exister, c’est-à-dire de la conscience réflexive à laquelle il accède par la pensée. L’impression subjective ou intérieure qu’il a d’exister a besoin d’être confirmée par une preuve objective, c’est-à-dire extérieure. Ainsi, lorsque par mon travail, je réalise matériellement ce dont j’ai d’abord eu l’idée, lorsque je contemple le produit de ce travail, je vois devant moi quelque chose qui n’existerait pas si je n’étais pas là, mais qui existe indépendamment de moi. Ainsi, l’artisan qui contemple son ouvrage perçoit dans ce qu’il a réalisé une preuve objective de l’impression subjective qu’il a d’exister.
Il est indispensable, quel que soit le métier que l’on exerce, que l’on s’inscrive d’une manière ou d’une autre dans un tel processus, c’est de cette manière également que le travail prend sens puisqu’il permet d’établir un lien avec le monde extérieur. Cela peut prendre un aspect relativement modeste, mais se rendre compte que l’on agit sur le monde et que l’on a pu contribuer à l’améliorer d’une manière aussi minime soit-elle ne peut qu’enrichir le sens que l’on donne à son travail. Celui qui parvient à en tirer ce type de satisfaction n’aura pas seulement l’impression qu’il ne travaille que pour gagner sa vie, mais en prenant conscience que ce qu’il fait est utile aux autres, il lui trouvera un sens plus riche.
Ainsi, le soignant qui perçoit en quoi il contribue au mieux-être des patients dont il a la charge verra qu’il exerce une action bénéfique sur autrui et en ressentira une intense satisfaction. Bien entendu, cette satisfaction n’est pas toujours au rendez-vous, il y a des échecs, des difficultés parfois insurmontables qui ne permettent pas toujours d’atteindre ses objectifs, mais le simple fait de les viser est déjà une source de sens. Cela dit, il faut, pour que le travail prenne réellement sens, qu’il se fasse dans des conditions qui rendent pleinement possible cette expression de la puissance d’agir humaine. Car ce qui est fréquemment à l’origine d’une grande souffrance au travail de la part des soignants, c’est de voir leur travail perdre son sens initial et aller dans le sens inverse de celui pour lequel ils avaient choisi de l’exercer.
Ainsi, m’est-il arrivé à plusieurs reprises d’entendre des aides-soignant.e.s ou des infirmier.e.s me dire qu’en raison du manque de temps ou de moyens, ils ou elles ont par moment le sentiment d’être maltraitants alors que le choix de ce métier repose de toute évidence sur une intention contraire. Ne pas parvenir à aller dans le sens des valeurs au nom desquelles on a choisi d’exercer une profession peut être une source importante de souffrance au travail et s’il est indispensable que cette profession s’inscrive dans un cadre strictement défini, il ne faut pas que celui-ci soit trop rigide et ne permette pas une souplesse dans l’accomplissement des tâches, ainsi que la possibilité de prendre des initiatives et d’adapter sa manière de faire à la singularité des situations auxquelles on peut se trouver confronter.
Le processus de reconnaissance passe également par autrui, il ne suffit pas de se reconnaître dans ce que l’on fait, il faut également être reconnu par d’autres, ceux avec qui l’on travaille et ceux pour qui l’on travaille. Il faut qu’une autre conscience me renvoie une certaine perception de moi-même et de ce que je fais pour que je puisse me sentir pleinement exister. Comme cela a été précédemment souligné, il n’y a de sens qu’inscrit dans un tissu relationnel et recevoir de la part d’autrui des signes signifiant que ce que l’on fait ne laisse personne indifférent est essentiel même si cette reconnaissance souligne certaines insuffisances. Il est parfois préférable d’envoyer des signes de reconnaissance négatifs plutôt que rien, ce qui est le plus souvent interprété comme du mépris. Cela dit, lorsqu’une personne commet des erreurs dans son travail, voire commet des fautes, il n’est pas nécessaire de la réduire ce qu’elle a fait, à sa dimension négative et il est préférable de lui exprimer les critiques que l’on doit lui adresser comme une invitation à s’améliorer plutôt que comme un jugement définitif et sans appel. C’est une manière de lui révéler le sens et l’importance de ce qu’elle fait.
Si le désir humain est puissance d’agir, il est aussi désir de reconnaissance, c’est-à-dire aspiration à se retrouver dans ce que cette puissance d’agir réalise et dans le regard d’autrui qui accorde une certaine valeur à ce que l’on fait. Il ne faut pas oublier que le travail est une activité essentiellement social et que celle-ci s’exerce avec et pour autrui, c’est-à-dire dans un tissu relationnel. Aussi, parmi les conditions qui contribuent à faire advenir le sens du travail, il y a la confiance, c’est-à-dire la croyance en la capacité de l’autre de bien faire. Il est important ici de souligner en quoi la confiance est une croyance. En effet, l’autre, je ne peux pas le connaître, je ne peux pas savoir « ce qui se passe dans sa tête », je peux que le supposer, c’est en ce sens que la confiance est une croyance, elle désigne littéralement la foi en l’autre. Ce que l’on remarque assez fréquemment, c’est que si l’on montre à une personne que l’on croit en elle, elle aura tendance à vouloir confirmer cette croyance et à s’améliorer, alors qu’à l’inverse celui en qui l’on ne croit pas ne parviendra pas nécessairement à progresser.
Cela signifie d’ailleurs qu’un management bienveillant doit également être un management exigeant, car veiller au bien de l’autre ce n’est pas faire preuve de complaisance à son égard, mais au contraire demander à la personne que l’on accompagne de donner le meilleur d’elle-même, ce qui n’est possible que si l’on croit en elle. Être exigeant envers autrui, c’est nécessairement croire en lui, c’est lui signifier qu’on l’estime capable de progresser. Bien entendu, l’exigence ne doit pas être démesurée, il ne faut pas adopter l’attitude perverse qui consiste à exiger d’autrui ce qu’il est incapable de faire pour le mettre en situation d’échec. Ce qu’il faut surtout lui montrer, c’est qu’il est capable de se rendre utile aux autres, c’est-à-dire de mettre sa puissance d’agir au profit de celle des autres. Travailler consiste, nous l’avons dit, à produire des biens et des services pour autrui et accomplir un travail qui a du sens, c’est également s’inscrire dans cette dynamique d’utilité au sens fort de ce terme. Il ne s’agit pas d’être utile dans un sens purement utilitariste, c’est-à-dire d’être réduit à l’état d’instrument en vue d’une finalité dont on ignore la véritable nature ou pire que l’on réprouve, mais que l’on contribue à réaliser par son travail uniquement pour gagner sa vie. Il s’agit plutôt d’être utile au sens où l’entend un philosophe comme Spinoza qui définit l’utile comme ce qui augmente la puissance d’agir des êtres humains, ce qui les rend actifs, c’est-à-dire capable de vivre activement et donc de ne pas subir leur existence.
En ce sens, toutes les professions qui relèvent du soin, du care, sont porteuses de sens, encore faut-il comme cela a déjà été dit qu’elle puisse s’exercer dans des conditions qui permettent à ce sens d’advenir.
Enfin, pour terminer, j’aimerais insister sur un point qui me tient fort à cœur et qui me semble essentiel pour faire apparaître le sens que nous pouvons donner à notre travail. Je veux parler de notre capacité à accepter ou non notre vulnérabilité et à en faire un critère pour juger du sens du travail que nous accomplissons. Cette notion de vulnérabilité, je l’emprunte aux éthiques du care qui se sont principalement développées à partir des années 80 aux États-Unis sous l’impulsion de femmes comme Carol Gilligan ou Joan Tronto qui ont renouvelé la philosophie morale en en modifiant les paradigmes, c’est-à-dire en partant de l’idée que l’être humain n’est pas un être foncièrement autonome, mais plutôt vulnérable. La vulnérabilité étant ici comprise au sens de dépendance. En effet, nous avons communément tendance à considérer comme vulnérable les personnes que nous jugeons dépendantes, les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, malades ou en situation de précarité. Aussi, en conséquence, nous avons également tendance à considérer toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ces catégories comme indépendantes, voire invulnérables. En réalité, nous savons tous au plus profond de nous-mêmes que nous sommes tous vulnérables parce que nous avons tous besoin les uns des autres pour vivre et développer ce qui fait notre humanité. C’est en ce sens que les éthiques du care – le care ne se résumant pas au soin, mais désignant également l’importance accordée aux personnes et aux choses, la sollicitude, la solidarité et l’entraide – ont développé une réflexion dans laquelle ce qui compte pour donner du sens à l’existence humaine, c’est précisément de prendre soin de soi et des autres et de contribuer à un épanouissement réciproque de soi et d’autrui. Cela rejoint une idée que l’on retrouve chez un philosophe qui m’est cher comme Spinoza et qui met en évidence dans son éthique, mais aussi dans sa philosophie politique, qu’en contribuant à l’augmentation de la puissance d’agir des autres, je contribue également à l’accroissement de la mienne et réciproquement. Autrement dit, pour développer pleinement notre humanité, pour nous épanouir, nous devons nous efforcer dans le but de faire coïncider l’utile propre et l’utile commun, c’est-à-dire ce qui contribue à l’augmentation de ma puissance d’agir et de celle d’autrui. Ainsi, le monde du soin est un exemple illustrant parfaitement cette idée. Plus un soignant contribue à améliorer les conditions de vie de ses patients, plus il voit sa puissance et la leur augmenter et c’est ce qui pour lui fait sens.
Par conséquent, le meilleur moyen de juger si le métier que j’exerce à un sens qui me permet de m’accomplir en tant qu’être humain, c’est de prendre comme pierre de touche, cette dimension du care. Est-ce que ce que je fais est vraiment utile aux autres, au sens où cela contribue à l’augmentation de leur puissance d’être et d’agir ? Mais pour se poser une telle question, il faut d’abord avoir pris conscience de sa vulnérabilité foncière et être en mesure de l’assumer pleinement.
Selon Paul Ricœur, la visée éthique consiste dans la « visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes ». On peut donc en conclure que plus un travail me permet d’avoir le sentiment que je vis une vie qui mérite d’être vécue, une vie pleinement humaine, en collaborant avec mes semblables pour leur permettre également de vivre une vie digne d’un être humain et que ce travail s’exerce dans une société organisée de telle sorte que tous et chacun puissent dispenser et jouir de tous les bienfaits que les êtres humains peuvent produire les uns pour les autres, plus ce travail a de sens.
Éric Delassus