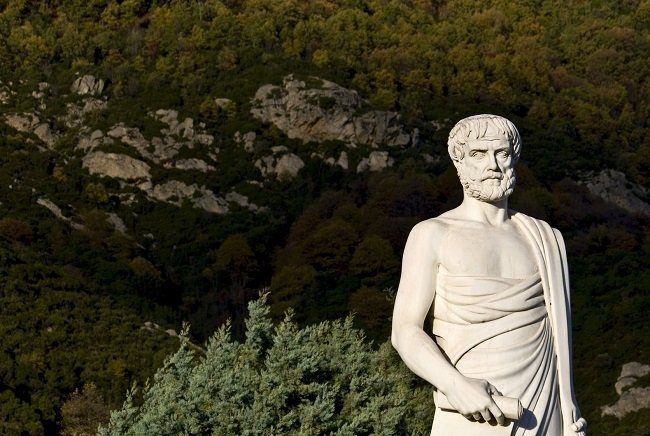Pourquoi aimons-nous faire des choses et les montrer aux autres ?
Posted in Articles on mars 19th, 2020 by admin – Commentaires fermés<a href= »https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/personnes »>Personnes photo créé par pressfoto – fr.freepik.com</a>
Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit dans les premiers penchants de l’enfant ; le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l’eau, admire en fait une œuvre où il bénéficie du spectacle de sa propre activité.
Hegel, Esthétique.
Souvent, lorsque les petits enfants rentrent de l’école, ils aiment montrer à leurs parents ce qu’ils y ont fait, un dessin, par exemple. Ils aiment qu’on leur demande de commenter leur réalisation et apprécie d’être complimentés pour la qualité de leur création.
Cette attitude n’est pas propre à l’enfant, les adultes aiment également soumettre au regard d’autrui les productions issus de leur travail ou de leurs loisirs. De l’artiste à l’ingénieur, de l’artisan à l’ouvrier en passant par le bricoleur du dimanche, chacun aime que l’on reconnaisse la valeur des œuvres auxquelles il donne le jour par son activité, qu’elle soit manuelle ou intellectuelle. Cette distinction entre le travail de la main et celui de l’esprit est d’ailleurs fort peu pertinente, car il n’y a que peut d’activités proprement humaines qui ne font appel qu’à l’une ou l’autre de ces capacités. L’artisan et l’ouvrier pensent autant que le scientifique ou l’écrivain qui ont besoin de leurs mains pour rédiger et écrire les résultats de leurs recherches et de leurs cogitations. D’où, d’ailleurs, ce très beau mot de « manuscrit » qui désigne ce que la main et l’esprit adossés l’un à l’autre ont pu engendrer. Mais, si l’on excepte le journal intime que l’on garde pour soi – et encore peut-être espère-t-on secrètement ou inconsciemment en le rédigeant qu’un jour ceux à qui on n’a pas osé dire ce que l’on y écrit le liront – lorsque nous composons un texte, c’est toujours pour être lu pour le soumettre au jugement d’autrui.
Il y a dans ce désir de montrer aux autres ce que l’on fait, la manifestation d’un puissant désir de reconnaissance, d’un intense appétit de se sentir exister et de voir confirmer ce sentiment d’existence.
Cette confirmation s’accomplit à deux niveaux, celui individuel de la création et de la reconnaissance de soi par soi et celui plus social de la reconnaissance par autrui.
Ce désir est d’abord satisfait par l’action elle-même, c’est ce que Hegel nomme dans son Esthétique, la prise de conscience de soi pratique, qu’il distingue de la prise de conscience de soi théorique. Prendre conscience de soi théoriquement consiste à saisir sa propre existence par la seule réflexion, il s’agit donc d’une prise de conscience toute intérieure et purement subjective. J’existe et par la réflexion, je me retourne sur moi-même et j’acquière le savoir de cette existence. J’en prends donc conscience. Or, cette prise de conscience ne suffit pas, c’est pourquoi l’être humain a besoin de construire un monde qui soit le produit de sa pensée consciente d’elle-même. Ainsi, l’enfant qui réalise un dessin, l’artisan qui fabrique son ouvrage, chacun pense également cette production avant et pendant sa réalisation. Une fois ce travail effectué, une fois l’objet produit, chacun a devant lui une preuve objective de son existence en tant qu’esprit, car la chose réalisée, celle qui se trouve devant lui – et n’oublions pas qu’étymologiquement « l’objet » désigne « ce qui est jeté devant » – ne serait pas là, si elle n’avait pas été conçue auparavant en son esprit. Ce second processus correspond à ce que Hegel appelle le prise de conscience de soi pratique, c’est-à-dire par l’action, par une opération qui permet à l’être humain de produire des effets dont il est la seule cause, hors de lui-même.
Mais nous ne sommes ici qu’au premier niveau du processus de reconnaissance. À ce stade, il est encore incomplet. Il a besoin pour s’accomplir pleinement du regard d’autrui.
En effet, tant que je me reconnais dans ce que j’ai fait, je reste malgré tout dans le cadre d’une relation de soi à soi, de soi à sa propre création ou production. Pour que le processus de reconnaissance s’accomplisse complètement, il est nécessaire qu’une autre conscience vienne corroborer cette première confirmation objective de ma propre existence.
Pour bien comprendre cela, il convient de préciser le sens à donner au terme de « reconnaissance ». Si l’on prend ce mot à la lettre, il désigne l’acte de connaître une seconde fois – re-connaître -, c’est bien d’ailleurs ce qui se produit lorsque nous reconnaissons quelqu’un dans la rue. C’est parce que nous le connaissons déjà que nous pouvons le reconnaître. Nous apercevons une silhouette, elle évoque pour nous une personne connue et lorsque cette forme se précise, nous re-connaissons cet autre que nous connaissions antérieurement.
Se sentir reconnu repose sur un processus identique. Il s’agit de sentir exister en tant qu’être humain par d’autres humains, de percevoir que d’autres, qui ont une certaine intuition de ce qui fait la spécificité de l’humanité, identifient en nous et dans nos œuvres cette humanité présente au plus profond de notre être.
L’être humain est un être de désir, c’est-à-dire animé d’une puissance créatrice qui ne demande qu’à s’exprimer hors de lui-même. Cette puissance fait la force d’un être qui n’aspire qu’à se sentir exister et à recevoir de l’extérieur des marques de reconnaissance. La tradition philosophique (de Platon à Freud) a souvent défini le désir comme manque, mais c’est là une vision appauvrie de cette force de vie qui nous anime. Le désir se perçoit comme manque lorsqu’il échoue et ne parvient pas atteindre ce qu’il vise ou lorsqu’il se trompe d’objet et confond l’avoir et l’être, s’imaginant qu’il sera assouvi par la possession d’objets, alors que c’est principalement dans l’action qu’il s’accomplit.
Sans désir, nous devenons apathiques, nous n’avons plus envie de rien, nous n’agissons plus et ne réalisons plus rien. L’absence de désir est le propre de la dépression, c’est-à-dire d’une diminution de notre puissance d’être et d’agir. Cette diminution, Spinoza la nomme tristesse, alors qu’à l’inverse, son augmentation n’est autre que la joie.
Si nous aimons faire des choses et les montrer, c’est donc parce que nous aspirons à la joie, c’est parce que la dynamique du désir est de sentir augmenter son intensité. Cette dynamique se trouve redoublée lorsqu’elle est perçue par d’autres dans le produit de nos actions, c’est pourquoi nous aimons leur montrer nos réalisations pour qu’ils deviennent les témoins confirmant ce sentiment d’exister qui nous met en joie.